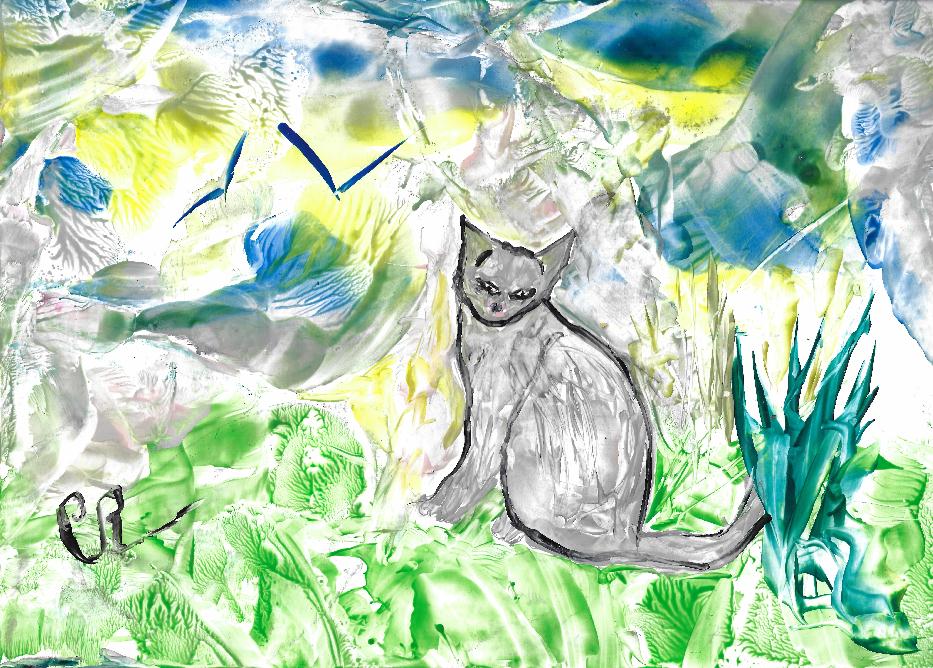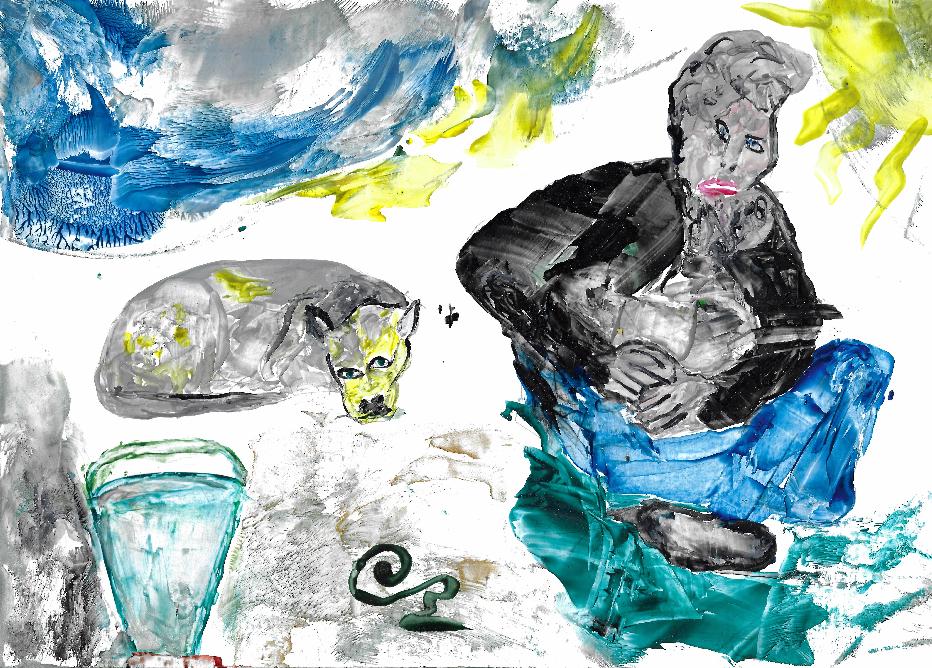LES CHEVEUX
J’aimais ses cheveux noirs comme des fils de jais
Et toujours parfumés d’une exquise pommade,
Et dans ces lacs d’ébène où parfois je plongeais
S’assoupissait toujours ma luxure nomade.
Une âme, un souffle, un cœur vivaient dans ces
cheveux
Puisqu’ils étaient songeurs, animés et sensibles,
Moi, le voyant, j’ai lu de bizarres aveux
Dans le miroitement de leurs yeux invisibles.
La voix morte du spectre à travers son linceul,
Le verbe du silence au fond de l’air nocturne,
Ils l’avaient ! voix unique au monde, que moi
seul
J’entendais résonner dans mon cœur taciturne.
Avec la clarté blanche et rose de sa peau
Ils contrastaient ainsi que l’aurore avec l’ombre ;
Quand ils flottaient, c’était le funèbre drapeau
Que son spleen arborait à sa figure sombre.
Coupés, en torsions exquises se dressant,
Sorte de végétal ayant l’humaine gloire,
Avec leur aspect fauve étrange et saisissant,
Ils figuraient à l’œil une mousse très-noire.
Épars, sur les reins nus, aux pieds qu’ils
côtoyaient
Ils faisaient vaguement des caresses musquées,
Aux lueurs de la lampe, ardents, ils chatoyaient,
Comme en un clair-obscur l’œil des filles masquées.
Quelquefois, ils avaient de gentils mouvements
Comme ceux des lézards aux flancs d’une
rocaille ;
Ils aimaient les rubis, l’or, et les diamants,
Les épingles d’ivoire et les peignes d’écaille.
Dans l’alcôve où brûlé de désirs éternels
J’aiguillonnais en vain ma chair exténuée,
Je les enveloppais de baisers solennels,
Étreignant l’idéal dans leur sombre nuée !…
Des résilles de soie, où leurs anneaux mêlés
S’enroulaient pour dormir ainsi que des vipères,
Ils tombaient d’un seul bond touffus et crespelés,
Dans les plis des jupons, leurs chuchotants repaires.
Aucun homme avant moi ne les ayant humés,
Ils ne connaissaient pas les débauches
sordides ;
Virginalement noirs sous mes regards pâmés
Ils noyaient l’oreiller avec des airs candides.
Quand les brumes d’hiver rendaient les cieux
blafards,
Ils s’entassaient, grisés par le parfum des
fioles,
Mais ils flottaient, l’été, sur les blancs
nénuphars,
Au glissement berceur et langoureux des yoles.
Alors, ils préféraient les bluets aux saphirs,
Les roses au corail, et les lys aux opales.
Ils frémissaient au souffle embaumé des zéphyrs,
Simplement couronnés de marguerites pâles !…
Quand parfois ils quittaient le lit, brûlants et
las,
Pour venir aspirer la fraîcheur des aurores,
Ils s’épanouissaient au parfum des lilas
Dans un cadre chantant d’oiseaux multicolores.
Et la nuit, s’endormant dans la tiédeur de l’air
Si calme qu’il n’eût pas fait palpiter des
toiles,
Ils recevaient ravis – du haut du grand ciel clair
–
La bénédiction muette des étoiles.
Mais elle pâlissait ; de jour en jour sa chair
Quittait son ossature atome par atome,
Et navré, je voyais son pauvre corps si cher
Prendre insensiblement l’allure d’un fantôme.
Puis à mesure, hélas ! que mes regards
plongeaient
Dans ses yeux qu’éteignait la mort insatiable,
De moments en moments, ses cheveux s’allongeaient,
Entraînant par leur poids sa tête inoubliable.
Et quand elle mourut au fond du vieux manoir,
Ils avaient tant poussé pendant son agonie,
Que j’en enveloppai comme d’un linceul noir
Celle qui m’abreuvait de tendresse infinie !…
Ainsi donc, tes cheveux furent tes assassins.
Leur longueur anormale à la fin t’a tuée ;
Mais, comme aux jours bénis où fleurissaient tes
seins,
Dans le fond de mon cœur, je t’ai perpétuée !…
(Le Parnasse contemporain, 1876, pages 364 à
80)